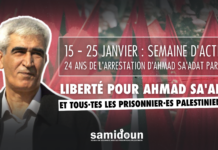L’article suivant, rédigé par la prisonnière libérée Ahlam Tamimi, a été publié en arabe le 23 avril 2025 dans Etar Online. Il revient sur l’histoire et le développement du mouvement des prisonnier·es palestinien·nes au fil des décennies. Nous le republions en français ci-dessous afin de mettre en lumière les contributions intellectuelles et le bilan historique du mouvement des prisonnier·es palestinien·nes, tels qu’ils sont documentés par les prisonnier·es elles·eux-mêmes.
Ahlam Tamimi est une journaliste et écrivaine palestino-jordanienne, originaire du village de Nabi Saleh en Palestine occupée et née à Zarqa, en Jordanie, en 1980. Elle est l’une des premières femmes à rejoindre les Brigades Izz el-Din al-Qassam. Suite à une opération, elle a été arrêtée et condamnée à 16 peines de prison à vie dans les prisons de l’occupation. Elle a été libérée lors de l’échange de prisonnier·es Wafa’ al-Ahrar arraché par la Résistance palestinienne en 2011 avant d’être expulsée vers la Jordanie. En 2017, le gouvernement américain a annoncé qu’il l’ajoutait à sa liste des personnes les plus recherchées et a offert une récompense de 5 millions de dollars pour sa capture. Les États-Unis ont demandé à plusieurs reprises qu’elle soit extradée de Jordanie, bien que les tribunaux jordaniens aient décidé qu’elle ne devait pas être livrée.
Retour historique sur les étapes de la lutte du Mouvement des Prisonnier·es Palestinien·nes
Ahlam Tamimi
Introduction
Le mouvement des prisonnier·es palestinien·nes est considéré comme l’un des éléments les plus importants de la lutte nationale palestinienne, car les prisonnier·es ont, au cours des dernières décennies, joué un rôle primordial dans la résistance contre l’occupation sioniste. Les prisons coloniales sont devenues des arènes de lutte et de confrontation qui ont conduit à la formation d’une conscience collective et d’une culture de résistance à l’intérieur des cellules, et ont contribué à l’élaboration des concepts de liberté, de résilience et d’appartenance nationale. Cet article cherche à examiner l’évolution historique du mouvement des prisonnier·es depuis 1967 et à analyser son rôle politique, organisationnel et militant.
Contexte historique
Les gangs sionistes ont adopté la politique de l’exécution sommaire après les arrestations et les interrogatoires violents dès les années 40. En 1949, cinq soldats sionistes ont arrêté une jeune fille palestinienne d’une vingtaine d’années, qu’ils ont ensuite assassinée après l’avoir violée et soumise à un interrogatoire violent. Les soldats ont admis, lors de leur procès, que le meurtre et le viol étaient le résultat d’ordres clairs et explicites. [1] Entre 1948 et 1967, l’occupation a utilisé de nombreux camps et prisons héritées du mandat britannique, pour y incarcérer des dizaines de milliers de Palestinien·nes, ce qui a conduit à la propagation de maladies et d’épidémies en raison du mauvais traitement et du surpeuplement. [2]
Phases de l’histoire du Mouvement des Prisonnier·es : Première phase : 1967-1970
Dès le début de l’occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza en 1967 et le lancement de la résistance armée à l’intérieur et à l’extérieur du pays, les autorités d’occupation sionistes ont commencé à arrêter des milliers de Palestinien·es et d’Arabes. Bien que cette phase de l’histoire du mouvement des prisonnier·es palestinien·nes ait été longtemps méconnue, de plus en plus de chercheur·ses commencent à la documenter. Lors d’une interview exclusive réalisée le 15 mars 2019 avec Mahmoud Bakr Hijazi (le premier prisonnier palestinien à avoir été incarcéré dans les cellules d’isolement de la prison d’al-Ramla[3]), ce dernier décrit les conditions de détention auxquelles il a été soumis lors de sa première incarcération. Cette incarcération a duré du 17 janvier 1965 au 21 février 1971, et pendant cette période, il a été complètement isolé du monde extérieur et soumis à une surveillance constante par le gardien, qui était remplacé toutes les 8 heures.
« Après mon arrestation, j’ai été soumis à des tortures physiques et à des pressions psychologiques pour me pousser à dénoncer mes camarades, et la blessure que j’avais subie lors de l’affrontement avec l’armée sioniste me faisait extrêmement mal. Après 1967, le nombre de fedayins emprisonnés a augmenté. Je n’ai jamais été autorisé à vivre avec eux ni à les rencontrer, et je leur criais des choses pour leur remonter le moral. J’étais sous surveillance constante et je n’avais pas le droit de contacter qui que ce soit. »[4]
L’occupation a condamné Mahmoud Hijazi à mort, faisant de lui le premier prisonnier palestinien à recevoir cette condamnation, après l’exécution d’Ata al-Zeer, Mohammad Jamjoum et Fuad Hijazi dans la prison d’Akka en 1933, ainsi que celle de Sheikh Farhan al Saadi [1937] et de Youssef en 1939[5]. La peine de mort de Hijazi a été annulée lors de l’audience en appel, et il a été libéré le 28 février 1971.
Les prisonnier·es palestinien·nes n’étaient pas mieux traité·es que les hommes. La prisonnière libérée Fatima Bernawi, qui a été arrêtée par les forces d’occupation en octobre 1967, raconte que les services pénitentiaires forçaient les prisonnières palestiniennes à travailler dans les buanderies et dans les champs de la prison d’al-Ramla. Elles étaient regroupées avec les prisonnières sionistes arrêtées pour prostitution et trafic de stupéfiants. Dans les années 1960, les prisonnières ont mené de nombreuses grèves de la faim pour obtenir quelques droits fondamentaux et basiques en détention. [6]
Les conditions de détention des premières générations de prisonnier·es étaient dures, et elles constituaient une forme d’esclavage et un outil de violence et de terreur dans le but d’ancrer la monstruosité du régime sioniste dans l’esprit des Palestinien·nes et de dissuader toute action militante, ouvrant la voie à l’élimination du projet de lutte de libération nationale dès ses prémices.[7]
La prisonnière libérée Aisha Odeh, arrêtée le 1er mars 1969, a documenté son expérience en prison dans son livre Dream of Freedom. Elle y décrit l’horreur des premiers interrogatoires, où les prisonnier·es subissaient des tabassages, accompagnés de crachats, d’insultes, de menaces d’agressions sexuelles, des séances d’électrochocs, tout en entendant d’autres prisonnier·es se faire torturer dans les cellules voisines, et en voyant parfois des cadavres et des corps traînés au sol, alors qu’elle était elle-même sur le point de mourir[8]. Aisha Odeh explique que la raison derrière toute cette cruauté était le choc de l’occupation face à la participation active et réussie des femmes dans la résistance. En 1969 de multiples opérations de résistance avaient été menées par des femmes telles que Aida Saad, Mariam al-Shakhshir, Lutfiya el-Hawari et Rasmea Odeh, parmi d’autres.
Durant cette période, les prisonnier·es ont subi et affronté les traitement brutaux infligés par l’administration pénitentiaire sioniste, qui les ciblait de manière systématique à travers des politiques de famine et d’isolement, dans une tentative de briser les militant·es et d’en faire des êtres épuisé·es, dociles et soumis·.
Leurs maigres repas étaient préparés par les prisonnier·es sionistes de la pire des manières, comme la « soupe de chénopode » qui consistait en quelques feuilles d’herbes dans une grande quantité d’eau, ainsi que la moitié d’un vieil œuf dur servi au petit-déjeuner[9]. En guise de tenue, les prisonnier·es portaient un uniforme unique, et il ne leur était pas permis d’apporter leurs propres vêtements. Chaque prisonnier·e ne possédait que deux couvertures et un mince matelas en cuir qui leur faisait office de lit, et iels étaient limité·es dans leur sommeil en raison des inspections quotidiennes, qui commençaient à 5h30 du matin et au cours desquelles les prisonnier·es étaient contraint·es de ranger leur lit et empêché de se rendormir. Les prisonnier·es devaient répondre aux gardiens par des formules imposées. Quant au temps de promenade, il ne dépassait pas 30 minutes ou, au mieux, une heure par jour.
Quant au travail forcé, il consistait, selon les écrits du prisonnier libéré William Nassar dans son livre Taghribat Bani Fatah, aux taches suivantes : [10]
- Travaux de nettoyage ; nettoyage des cellules, des couloirs et des bureaux des gardiens sous menace de punition ou de mise en isolement.
- Main d’oeuvre et bricolage ; réparation de meubles ou fabrication de filets pour les tanks utilisés par les soldats à des fins de camouflage.
- Travaux pénibles dans les cours de la prison ; comme pelleter de la terre, déplacer des pierres et nettoyer les cours de promenade, le tout gratuitement.
- Services obligatoires ; comme repasser les uniformes militaires des gardiens, leur offrir du café, du thé et de la nourriture, ou exécuter des ordres personnels humiliants.
Il n’y avait pas de raisonnement factionnel ou de distinctions organisationnelles durant cette période, car les prisonnier·es se considéraient comme les défenseurs d’une révolution collective et commune. Des politiques quietistes et régionalistes ont émergé, soutenues secrètement par le Service Pénitentiaire Israélien (IPS), afin de détourner l’esprit des prisonniers de tout ce qui concernait leur patrie et la lutte de libération nationale.[11]
Cette phase, malgré sa dureté, a constitué le point de départ des futures révoltes et des manifestations de désobéissance dans les prisons sionistes, ainsi que de l’utilisation des grèves de la faim, que nous aborderons plus tard.
La deuxième phase : 1970-1973
Après l’augmentation du taux d’incarcération parmi les révolutionnaires appartenant à des organisations, ces dernier·es ont refusé la politique de travail forcé qui leur était imposée. En représailles, ils ont été soumis à l’isolement, à l’interdiction des visites familiales et à des passages à tabac réguliers. Avec la constitution d’un noyau organisationnel parmi les prisonnier·es du Fatah et du Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP), la rébellion contre le travail forcé a éclaté, et le nombre de celles et ceux qui s’y opposaient a augmenté, les grèves de la faim étant utilisées comme un outil pour obtenir des droits en détention.
C’est durant cette phase que les prisonnier·es ont lancé leur première grève de la faim le 18 février 1969, dans la prison d’al-Ramla. La grève a duré 11 jours avant de finalement échouer, car les prisonnier·es ont été soumis à la répression, à l’isolement et à des sanctions. [12] Lors de cette grève, les dirigeants du mouvement des prisonnier·es de l’époque, dont Abdulhamid al-Qudsi, Kamel al-Nemri et William Nassar, entre autres, ont été placés en isolement et ont été violemment battus par le directeur de la prison de Ramla, jusqu’à ce qu’ils soient transférés à la prison d’Ashkelon. [13] Simultanément, une grève de la faim dans la prison de Kfar Yona a été lancée, elle a duré 8 jours et a fini par obtenir certaines des revendications, telles que l’autorisation pour les prisonnier·es d’avoir des fournitures de bureau et le fait que les prisonniers n’aient plus à répondre par “oui, monsieur”, ou tout autre formule imposée, une mesure qui était exclusive à Kfar Yona. [14]
Le prisonnier libéré Shawqi Shahrour raconte :
« J’ai été transféré, avec les dirigeants de la grève, à la prison d’Ashkelon. C’est une prison spécialement conçue pour briser le moral du prisonnier, l’humilier et le discipliner. Nous avons été accueillis par une série de coups que nous appelions “al-tashrifah” (l’attribution d’honneurs) ; nous devions marcher dans un long couloir, avec des soldats de chaque côté tenant des matraques et des fils électriques. Nous avons été battus presque jusqu’à la mort, nus, sous prétexte que nous étions des criminels. Je me souviens que ma tête était enflée et que mon corps saignait. Nous avons ensuite été aspergés de DDT et enfermés dans des cellules où se trouvaient vingt prisonniers, sans recevoir de soins ou suffisamment de nourriture, tout en continuant à être battus à l’intérieur des chambres en fonction de l’humeur du gardien, auquel nous ne pouvions nous adresser qu’en disant “oui, monsieur.” [15]
Les conditions de détention dans la prison d’Ashkelon étaient humiliantes. En réponse, les prisonnier·es ont lancé une grève de la faim le 5 juillet 1970, qui a duré environ une semaine. Grâce à cette campagne de grève de la faim, les prisonnier·es ont pu obtenir quelques maigres demandes, telles que l’augmentation de la durée du temps de promenade, la possibilité de recevoir des vêtements de leurs familles et l’octroi de fournitures de bureau. Malgré les difficultés extrêmes, les prisonnier·es ont réussi à limiter l’ampleur des agressions qui leur étaient infligées. [16]
La troisième phase : 1973 – 1980
Cette phase a été marquée par l’effort visant à organiser les groupes de la résistance palestinienne à l’intérieur des prisons et à l’imposer aux geôliers comme un système de vie interne, transformant ainsi la vie des prisonnier·es du chaos à l’ordre. Les prisonnier·es ont également lutté pour obtenir les droits garantis par les chartes internationales, ce qui les a poussés à lancer plusieurs grèves de la faim au cours de cette période, parmi lesquelles :
-
La grève dans la prison d’Ashkelon, qui a duré du 13 avril 1973 jusqu’au 7 octobre 1973.
-
Une grève de la faim lancée depuis la prison d’Ashkelon le 11 décembre 1976, qui s’est propagée à toutes les autres prisons. Elle a duré environ 45 jours, après que les prisonnier·es se soient organisés de manière à ce que chaque chambre ait ses propres représentant·es, et un représentant général pour chaque prison pour parler au nom des prisonnier·es de toutes les factions. De plus, une liste de revendications a été présentée à l’administration de la prison d’Ashkelon, la première étant la fin de la politique des passages à tabac constants. Certaines de ces demandes ont été satisfaites, comme la gestion de la bibliothèque par les prisonnier·es et le remplacement des matelas pourris par de nouveaux. Cependant, l’administration de la prison a violé d’autres accords, ce qui a conduit les prisonnier·es à lancer une autre grève de la faim le 24 février 1977, durant 20 jours, pour exiger la mise en œuvre de ces droits. [17]
La quatrième phase : 1980 – 1985
L’administration pénitentiaire sioniste a pris conscience du rôle important joué par les organisations palestiniennes à l’intérieur des prisons et a réalisé le travail culturel mené par les prisonnier·es. En effet, ces dernier·es organisaient des sessions culturelles et publiaient des journaux clandestins mensuels écrits sur le dos des emballages alimentaires ; parmi lesquels figuraient le magazine Thawra (Révolution) et le journal Hurriyah (Liberté), qui offraient aux prisonniers l’opportunité d’écrire des articles sur divers sujets. [18] En réponse, le régime sioniste a décidé d’ouvrir la prison de Nafha en 1980. Dans cette prison, les dirigeants du mouvement des prisonnier·es étaient incarcérés dans des conditions très dures, avec une nourriture de mauvaise qualité servie en très faible quantité. Les prisonniers étaient totalement isolés du monde extérieur, entassés dans des cellules surpeuplées sans ventilation, les ustensiles d’écriture et le matériel de papeterie étaient confisqués. Cela les a poussés à se coordonner avec les prisonnier·es des prisons d’Ashkelon et de Bir al-Saba pour lancer une campagne de grève de la faim collective qui a débuté le 14 juillet 1980 et a duré 33 jours. [19]
En parlant de sa grève de la faim, le prisonnier libéré Azmi Mansour raconte :
« Pendant cette grève de la faim, les prisonniers Rasim Halawa, Ali al-Jaafari, Ishaq Maragha et Anis al-Dawla ont été assassinés et se sont élevés en martyrs. Ali était mon ami et nous étions dans la même cellule. [20] Ils l’ont tué en le nourrissant de force à l’aide d’un tube laryngé, puis ils ont prétendu qu’il s’était suicidé. » [21]
La grève de la faim s’est ensuite propagée dans toutes les prisons, et les prisonnier·es ont arraché d’autres droits élémentaires, comme le fait d’avoir des lits ou encore d’avoir des cellules plus grandes. Cette grève a également été marquée par le mouvement populaire et médiatique de solidarité qui a suivi le martyr de ces quatre prisonniers.
En 1984, les prisonniers de la prison de Juneid ont obtenu un nombre encore plus élevé de revendications après avoir mené une grève de la faim de 13 jours, soutenue largement à l’extérieur par la population palestinienne, ce qui a contribué à son succès. Par la suite, des télévisions, des radios, des écouteurs et des cassettes ont été introduits dans les prisons, ainsi que des couvertures et des pyjamas fournis par les familles des prisonnier·es, ce qui a considérablement amélioré leur vie quotidienne et leur a donné un certain degré de stabilité, leur permettant ainsi de prioriser leur culture et de renforcer leur militantisme.
La cinquième phase : 1985 – 1993
Après l’opération al-Jalil, qui a permis la libération de plus de 1000 prisonnier·es palestinien·nes en 1985, y compris celles et ceux condamnés à de longues peines ou à la réclusion à perpétuité , les prisonnier·es ont cherché à reconstruire les organisations palestiniennes, notamment après l’émergence des organisations de la résistance islamique. Ainsi, l’autorité pénitentiaire sioniste a décidé de revenir sur les acquis arrachés auparavant par les prisonniers, les forçant à lancer une grève de la faim le 27 mars 1987, menée d’abord par les détenus de la prison de Juneid, et suivie ensuite par les autres prisons. Cette grève a duré 20 jours, mais n’a pas permis d’obtenir leurs revendications.
Des milliers de personnes ont été arrêtées lors des premiers jours de la première Intifada en décembre 1987, et la répression s’est intensifiée dans les prisons. Cela a continué jusqu’en 1992, après que les prisonnier·es aient lancé une grève de la faim le 23 juin 1991, qui a échoué, principalement en raison de la guerre du Golfe et de l’instabilité de la situation politique régionale.
Les prisonnier·es ont décidé de lancer une grève de la faim d’une importance cruciale le 25 septembre 1992, qui a réuni des prisonnier·es de toutes les prisons, avec environ 7000 participant·es au total. Cette grève a connu un grand succès, a restauré l’équilibre du rapport de force en détention et a permis d’arracher plusieurs victoires : la fin des fouilles corporelles, la fermeture de la section d’isolement de la prison de Ramla, la reprise des visites familiales avec une durée plus longue, ainsi que l’autorisation de visites privées, l’ajout de choses supplémentaires dans la liste des achats autorisés et l’introduction de plaques de cuisson et d’équipements de cuisine dans les chambres [22], ainsi que la possibilité de poursuivre des études universitaires à l’Université Hébraïque Ouverte. [23]
La sixième phase : 1994 – 2000
La signature des Accords d’Oslo et la création de l’Autorité palestinienne (AP) ont eu un impact sur la situation des prisonnier·es incarcéré·es dans les prisons sionistes. Les prisonnier·es se sont divisés en deux groupes: d’une part, ceux et celles qui soutenaient les accords, pensant que cela mènerait à leur libération, et d’autre part, les marxistes et les penseurs islamiques qui s’opposaient aux accords et ne croyaient pas qu’ils mèneraient à la libération des prisonnier·es. [24]
Cette phase a été caractérisée par une stabilité économique du côté des prisonnier·es, en particulier après la création du Palestinian Prisoners Society et, plus tard, du Ministère des Affaires des Prisonnier·es et des Ex-Prisonnier·es. Les prisonnier·es ont obtenu certains droits grâce à la situation générale à l’exterieur des prisons, qui s’est reflétée sur eux. Les visites régulières des avocats du Palestinian Prisoners Society et du Ministère des Affaires des Prisonnier·es ont facilité la relation avec l’AP, ce qui a contribué à l’aboutissement de certaines revendications des prisonnier·es, dont la reprise de l’éducation universitaire et l’organisation du soutien financier pour les prisonnier·es et leurs familles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des prisons, selon une échelle salariale spéciale, leur offrant ainsi une stabilité relative. Malgré cela, la question qui revenait sans cesse dans l’esprit des prisonnier·es était celle de leur libération dans le cadre des Accords d’Oslo et de la relation pacifique entre l’AP et le régime colonial sioniste, ce qui a conduit à un affaiblissement des factions en interne et à une baisse du niveau de la culture organisationnelle. [25]
Certain·es prisonnier·es ont été libéré·es après les Accords d’Oslo, dans le cadre des initiatives de “bonne volonté”, mais bon nombre de prisonniers de longue date ou ceux condamnés à de longues peines ont été tenus à l’écart de ces libérations, ce qui a entraîné une baisse du moral des prisonnier·es et leur désillusion face à la direction de l’AP. Le prisonnier libéré Israr Sumrain déclare avoir été profondément déçu après avoir vu le prisonnier Ahmad Abu al-Sukkar ne pas être libéré par les Accords d’Oslo, ce qui l’a amené à se demander : « Si Abu al-Sukkar n’a pas été libéré, alors quand serons-nous libérés ? »
Cela a poussé les prisonnier·es à lancer une grève politique sous le slogan « Les Accords d’Oslo ne les ont pas libérés : libération des prisonniers hommes et femmes sans exception ! » le 18 mars 1995, qui a duré 18 jours. Cette grève visait à délivrer un message politique à l’AP et au peuple palestinien à la lumière de la situation d’accalmie que traversait alors la scène palestinienne à l’extérieur. [26]
Cette phase a été marquée par des grèves politiques, qui ont adressé plusieurs messages à l’Autorité palestinienne. La grève de 1995 a été suivie par une autre grève le 5 février 1998, qui a duré seulement 10 jours et a été menée uniquement par les prisonniers de l’OLP, sans la participation des prisonniers des mouvements de la résistance islamique. Puis, une autre grève a eu lieu le 1er mai 2000, qui a duré 30 jours. Cette grève a commencé après l’ouverture de la prison de Hadareem et l’isolement d’un certain nombre de prisonniers, ainsi que la tentative de remplacer le filet de séparation par du verre lors des visites familiales des prisonniers. Cette grève a été accompagnée d’un large mouvement de solidarité populaire, ce qui a conduit à plusieurs martyrs. Ces grèves se sont propagées davantage, avec des prisonniers d’Asqelan, Nafha et Shatta qui se sont joints au mouvement, portant le nombre de prisonnier·es en grève de la faim à environ 1500, ce qui a finalement conduit à l’aboutissement de la majorité des revendications humanitaires, telles que : la sortie des prisonniers incarcéré alors en isolement, la reprise de l’éducation universitaire et l’arrêt de la politique des fouilles à nu. Cependant, tous ces acquis ont été complètement annulés et effacés après l’éclatement de l’Intifada d’Al-Aqsa en 2000. [27]
La septième phase : 2000 – 2006
Après l’éclatement de l’Intifada d’Al-Aqsa le 28 septembre 2000 et l’arrestation de nombreux Palestinien·nes, l’administration pénitentiaire sioniste a ouvert de nouvelles prisons et de nouvelles sections. D’anciennes prisons telles qu’al-Ramla, Kfar Yona, Hadarim, Gilboa et Ramon ont également été ré-ouvertes. La plupart des acquis des prisonnier·es ont été annulés et une politique de fouilles quotidiennes des chambres des prisonnier·es a été imposée. La situation des prisonnières à la prison de Ramla s’est détériorée, ce qui les a amenées à mener une grève de la faim pendant 8 jours à partir du 26 juin 2001, suivie de leur participation à la grève de la faim générale des prisons le 15 août 2004, ce qui a permis d’obtenir certaines revendications de base après 19 jours de grève de la faim.
L’arrestation d’un grand nombre de Palestinien·es à la suite de cette Intifada a conduit à la détérioration des relations entre eux et les prisonnier·es plus ancien·nes, créant une véritable fracture. Le prisonnier libéré Fakhri al-Barghouti déclare :
« C’était une phase difficile, où les prisonniers des services de sécurité de l’AP ne souhaitaient pas participer à l’organisation générale dans la prison. Cette période a vu la priorisation des intérêts personnels au détriment de l’intérêt général, et les prisonniers plus âgés en sont ressorti épuisés, en raison de l’écart d’âge, intellectuel et organisationnel entre eux et les nouveaux·elles prisonnier·es. » [28]
La huitième phase : 2007 – 2019
A cette époque, la division intra-palestinienne a dominé le mouvement des prisonnier·es. Leur vie dans les prisons sionistes étaient alors divisée en fonction de l’organisation à laquelle ils appartenaient, chaque organisation ayant ses représentant·es, ses sections et son agenda, ce qui a affaibli leur position face au régime sioniste. Les rangs nationaux des prisonnier·es se sont divisés, ce qui a amené un certain nombre de prisonnier·es de différentes organisations palestiniennes à lancer une initiative de réconciliation le 27 juin 2007, connue sous le nom de “Document de Réconciliation Nationale des Prisonnier·es”. Cependant, cette initiative n’a pas réussi à régler les différends internes. Après l’arrestation d’un grand nombre d’enfants et d’aolescent·es à la suite de l’Intifada d’al-Quds de 2015, l’administration pénitentiaire sioniste a lancé une offensive dans toutes les prisons, ce qui a demandé un grand effort de la part des prisonnier·es pour intégrer et soutenir les nouveaux détenus et protéger leurs droits. Cette phase a été marquée par un affaiblissement de l’unité interne, ainsi que par des plans stratégiques et une position générale fragiles. [29]
L’année 2011 a vu la libération de plus de 1000 prisonnier·es palestinien·nes, après l’accord d’échange entre le régime sioniste et le Hamas. Quelques mois plus tard, les prisonnier·es du Hamas et du PFLP en isolement ont mené une grève de la faim le 17 avril 2012, dans le but de mettre fin à leur isolement et de rejoindre les autres prisonniers dans les cellules collectives. Cette grève a vu naitre une solidarité organisationnelle qui, bien qu’elle n’ait pas inclus toutes les organisations, a finalement abouti à la réussite de l’initiative. Néanmoins, l’accord d’échange a aussi entraîné un sentiment de frustration parmi ceux et celles qui sont restés en prison, car ils n’étaient pas inclus dans les libérations. Le prisonnier libéré Amjad Abu Latifa déclare :
« Après l’accord et l’application de la réglementation Shalit, les mesures disciplinaires ont été rétablies et la plupart des avantages ont été supprimés, surtout pour les prisonnier·es de la bande de Gaza, qui ont été soumis·es à des mesures deux fois plus sévères, et ont été totalement privé·es de visites familiales, étant isolés dans leurs sections. » [30]
Les effets de la division intra-palestinienne sur l’état général du mouvement ont conduit les prisonniers en détention administrative à décider de lancer une grève de la faim le 24 avril 2014, pour exiger l’abolition de la détention administrative. Cette grève a suscité un large mouvement de solidarité et a duré 63 jours, devenant ainsi la plus longue grève de la faim menée par des prisonniers en détention administrative dans l’histoire du mouvement des prisonnier·es. Elle a été ensuite suspendue après l’instauration d’une limite d’un an pour la détention administrative. [31]
Cette phase a vu émerger des grèves de la faim individuelles, auxquelles certains prisonniers ont été contraints de recourir en raison de la division dans les rangs du mouvement national des prisonnier·es. Certaines de ces grèves ont duré plusieurs centaines de jours voir plus. L’année 2012 a été marquée par plusieurs grèves de la faim individuelles, comme celle menée par Khader Adnan pendant 66 jours, la grève de la faim menée par Thaer Halahleh pendant 76 jours, Hana Shalabi qui a mené en grève de la faim pendant 44 jours, ou Samer Issawi qui a dépassé toutes les attentes en menant une grève de la faim pendant 265 jours, ce qui reste la plus longue grève de la faim individuelle de l’histoire du mouvement des prisonnier·es palestinien·nes. [32]
La neuvième phase : 2020 – Déluge d’Al-Aqsa
Les prisonnier·es incarcéré·es lors de cette phase ont été confronté·es à la pandémie de coronavirus, qui s’est rapidement propagée au sein des prisons, en raison du manque de désinfectants, d’antiseptiques et de mesures préventives. Cette situation a conduit à une augmentation du nombre de prisonnier·es infecté·es. Cette période a également été marquée par l’évasion de six prisonniers de la prison de Gilboa en septembre 2021, à savoir Zakaria Zubeidi, Mahmoud al Ardah, Yacoub Qadri, Ayham Kamamji, Mohammad al Ardah et Munadil Nafa’at. Leur évasion a été suivie par une série de mesures de sécurité renforcées après leur capture. En réponse, les prisonnier·es ont mené deux grèves de la faim en 2022, qui ont abouti à l’application de leurs revendications après que ces derniers aient menacé de dissoudre leurs organisations et structures et de se lancer dans une rébellion totale. [33]
À la suite du Déluge d’Al-Aqsa, qui a commencé le 7 octobre 2023 et de l’offensive génocidaire, le nombre de prisonnier·es a considérablement augmenté, dépassant la barre des 16 000 prisonnier·es, tandis qu’environ 59 prisonniers ont été martyrisés depuis le début du génocide. [34] (NDLR : à l’heure où nous publions cette traduction, au moins 65 prisonnier·es ont été déclarés martyrs dans les prisons sionistes depuis le 7 octobre 2023).
Le régime sioniste utilise des méthodes de torture inédites contre les prisonnier·es, tant hommes que femmes, incluant le viol et autres agressions sexuelles, et l’utilisation de chiens à des fins d’intimidation. Cela a conduit à l’annulation de tous les acquis historiques du mouvement des prisonnier·es et à un retour à la case départ. Le camp de détention de Sde Teiman, a également été ouvert, spécifiquement conçue pour incarcérer les prisonnier·es de la bande de Gaza, à l’encontre desquels des crimes de guerre violant le droit international et les conventions de Genève sont commis quotidiennement, et sans que les noms des détenus ne soient transmis à aucune entité juridique. L’avocat Khaled Mahajneh a transmis les témoignages de plusieurs prisonniers enfermés à Sde Teiman, qui ont rapporté des conditions extrêmement cruelles, telles que : l’enchainement des membres et les yeux bandés 24 heures sur 24, l’interdiction pour les prisonniers de changer leurs vêtements, la propagation de maladies et d’épidémies, notamment des maladies de la peau comme la gale, la soumission des prisonniers à un régime de sécurité maximum et à des agressions par des gardes armés, l’interdiction de communiquer entre eux ou de pratiquer leur religion, la possibilité de se doucher une fois par semaine uniquement, voire moins, la réduction de la quantité de nourriture, et des passages à tabac soudains et systématiques. [35]
Dans les autres prisons sionistes, l’administration pénitentiaire coloniale a isolée les dirigeants historiques du mouvement des prisonnier·es, les a brutalement agressés, leur a refusé l’accès à des soins médicaux, et a tenté d’assassiner plusieurs prisonnier·es et leader·ses du mouvement. De plus, leurs effets personnels ont été confisqués, et iels ont été dispersé·es dans différentes prisons. [36]
Malgré la libération de prisonnier·es palestinien·nes en sept vagues successives, lors de la première phase de l’accord d’échange arraché lors du Déluge d’Al-Aqsa entre le Hamas et le régime sioniste, les arrestations se poursuivent toujours, et les conditions dans les prisons continuent de se détériorer jour après jour alors que le génocide fait rage.
Conclusion…
L’histoire du mouvement des prisonnier·es palestinien·nes est riche en sacrifices et en évolutions, illustrant la résilience du peuple palestinien et sa détermination à arracher la libération. Elle constitue un point central pour comprendre le développement de la lutte de libération nationale palestinienne, car elle reflète l’ampleur de l’évolution de la résistance à l’intérieur même des prisons.
Et malgré les tentatives constantes de répression et d’effacement exercées par le geôlier, les prisonnier·es ont su inscrire leur présence au cœur de la conscience collective nationale. Dès lors, il est indispensable d’étudier ce mouvement afin de saisir l’un des piliers les plus importants de la lutte palestinienne contemporaine, et de maintenir la cause des prisonnier·es comme une priorité tant sur le plan palestinien qu’international.
Notes :
[1] Al-Tamimi, Ahlam Aref, “Communication Activities for Palestinian Prisoners in Israeli Occupation Prisons: Towards a Theoretical Concept of the Prisoners’ Information Concept”, mémoire de master publié, 2019, Université du Moyen-Orient, Jordanie.
[2] Liddawi, Mustafa Yousef, “the Free Prisoners, Hawks in the Nation’s Sky”, première édition, 2013, Dar Al-Farabi, Beyrouth, Liban.
[3] Mahmoud Bakr Hijazi est décédé le 22 mars 2022 à Ramallah.
[4] Al-Tamimi, source précédente.
[5] Site de l’Autorité des affaires des prisonniers et ex-prisonniers, “The prisoners’ movement origin and development”, publié le 29/03/2019, consulté le 13/04/2025, https://2u.pw/6ZiuGML.
[6] Memory of Palestine, entretien avec l’ancienne prisonnière libérée Fatima Bernawi, consulté le 13/04/2025, https://2u.pw/MCmyl.
[7] Qaraqe, Issa, Palestinian prisoners in Israeli prisons after Oslo 1993-1999, mémoire de master publié, 2001, Université de Birzeit, Palestine.
[8] Odeh, Aisha, Dreams of Freedom, 2004, Muwattin : Fondation palestinienne pour l’étude de la démocratie, Ramallah, Palestine.
[9] Memory of Palestine, entretien avec l’ancien prisonnier libéré Shawki Shahrour, consulté le 13/04/2025, https://2u.pw/iBDHh.
[10] Nassar, William, “Ghariba Bani Fath: forty years in the Fathawi mazei”, 2005, Dar Al Shurouk, Jordanie.
[11] Autorité des affaires des prisonniers et ex-prisonniers, source précédente.
[12] Centre national d’information palestinien, La grève de la faim la plus célèbre, consulté le 14/04/2025, https://info.wafa.ps/pages/details/32928.
[13] Memory of Palestine, entretien avec l’ancien prisonnier libéré Abdul Hamid Al-Qudsi, consulté le 14/04/2025, https://2u.pw/t9lUL.
[14] Centre national d’information palestinien, source précédente.
[15] Memory of Palestine, source précédente.
[16] Memory of Palestine, entretien avec l’ancien prisonnier libéré Azmi Mansour, consulté le 14/04/2025, https://2u.pw/UJIBG.
[17] Al-Azza, Muhannad, the date of the hunger strike in the prisons of the Israeli enemy, revue Al-Adab, consulté le 14/04/2025, https://2u.pw/7Eu7o.
[18] Idem.
[19] Idem.
[20] Tube inséré par le nez dans l’estomac du prisonnier, de manière coercitive, pour le nourrir de force avec une substance liquide, afin de briser sa grève de la faim.
[21] Memory of Palestine, source précédente.
[22] Ces ustensiles de cuisine incluent la “tuile”, un réchaud utilisé par les prisonniers pour cuisiner leur nourriture.
[23] Hamdouna, Raafat Khalil, Creative aspects of the history of the Palestinian prisoners’ national movement between 1985-2015, étude de recherche publiée, 2018, Ministère de l’Information, Palestine.
[24] Ziyad, Ziyad Musa, the impact of the Oslo era on the unity and achievements of the prisoners’ movement in Israeli prisons 1993-2012, mémoire de master publié, 2012, Palestine, https://2u.pw/7ov4x.
[25] Al-Tamimi, Nizar, entretien téléphonique daté du 15/04/2025.
[26] Memory of Palestine, entretien avec l’ancien prisonnier libéré Israr Sumrain, consulté le 15/04/2025, https://2u.pw/15kTZ.
[27] Al-Tamimi, source précédente.
[28] Memory of Palestine, source précédente.
[29] Abu Mohsen, Jamal, History of the Prisoners’ Movement, 2024, publié par l’Université arabo-américaine, Palestine.
[30] Memory of Palestine, entretien avec l’ancien prisonnier libéré Amjad Abu Latifa, consulté le 15/04/2025, https://2u.pw/T3KXI.
[31] Sadiq, Mervat, “Suspension of the prisoners’ strike after an agreement with the Israeli intelligence” site d’Al-Jazeera, consulté le 15/04/2025, https://2u.pw/nZr4J.
[32] Rajoub, Awad, “The most prominent individual strikes of Palestinian prisoners”, 2022, site d’Al-Jazeera, consulté le 15/04/2025, https://2u.pw/ySlcD.
[33] Al-Asa, Fadi, “Palestinian prisoners flee Gilboa Prison”, 2021, site d’Al-Jazeera, consulté le 15/04/2025, https://2u.pw/sX0JuEh.
[34] Statistiques du Club des prisonniers palestiniens, 2025.
[35] “The first lawyer to visit “Sde Teman””, rapport publié sur le site de la chaîne Al-Arab TV, 2024, consulté le 15/04/2025, https://2u.pw/bjJIq.
[36] Abu Mohsen, citation précédente.
En savoir plus sur Samidoun : réseau de solidarité aux prisonniers palestiniens
Subscribe to get the latest posts sent to your email.