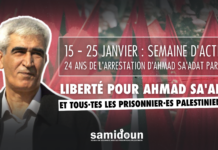Dernière minute ! (6 mai 2025) – Les forces d’occupation viennent d’arrêter à nouveau le prisonnier libéré Wael Jaghoub après avoir fait irruption chez lui, à Naplouse. Il avait été libéré d’une sentence à vie dans les geôles coloniales sionistes lors du récent échange de prisonniers Toufan al-Ahrar.
L’article suivant, écrit par Wael Jaghoub, prisonnier palestinien libéré lors de l’échange de prisonnier·es “Toufan al-Ahrar” arraché par la Résistance Palestinienne et la fière et inébranlable population de Gaza, a été publié à l’origine en arabe dans Al-Akhbar à l’occasion de la Journée des prisonnier·es palestinien·nes, le 17 avril 2025.
Né le 23 mai 1967, Wael Jaghoub s’est engagé très jeune dans la lutte de libération nationale. Il a été arrêté par l’occupation pour la première fois en 1992, lors de la première Intifada, et condamné à six ans de prison. Avec le déclenchement de l’Intifada Al-Aqsa, il est devenu l’un des dirigeants actifs du Front Populaire pour la Libération de la Palestine à Naplouse. Il a été arrêté le 1ᵉʳ mai 2001 et condamné à la prison à vie. Durant ses années d’incarcération, il a subi l’isolement et l’interdiction de visites familiales ; derrière les barreaux, il est devenu écrivain, publiant plusieurs livres ainsi que de nombreux articles et études, dont cet article de 2016. À sa libération, il a déclaré :« Je n’ai jamais perdu espoir, pas un seul instant, dans le fait que la résistance finirait par me libérer… et je garde l’espoir qu’elle libérera ceux qui sont restés [en prison]. »
Le Mouvement national des prisonnier·es palestinien·nes, d’abord et toujours !
Journée des prisonnier·s palestinien·nes : Sur l’expérience de la lutte à l’intérieur des prisons
Wael Jaghoub
Il est inévitable que l’expérience de lutte des prisonnier·es palestinien·nes dans les prisons sionistes — prolongement naturel de la condition palestinienne dans son ensemble — prenne en compte la particularité de cet espace, et, en conséquence, l’importance des concepts produits par cette expérience spécifique, qui portent et expriment cette dimension.
La lutte menée en prison est un affrontement quotidien et direct avec le système colonial dans tous ses aspects — politique, sécuritaire, judiciaire et médical. Dans le même temps, c’est une confrontation où se joue la défense du système moral et intellectuel incarné par la personne emprisonnée, que le régime colonial tente de dominer, en le dépouillant de ses caractéristiques humaines et morales. La lutte débute lorsque le prisonnier affronte son geôlier et défend son humanité et ses valeurs morales, faisant de cet affrontement un combat existentiel.
Il convient de souligner que les concepts régissant cette lutte sont issus de l’expérience spécifique vécue à l’intérieur des prisons, au premier rang desquels figure l’espoir — à la fois comme valeur morale et comme principe — reposant également sur la volonté et la conscience.
La conscience collective constitue un lien vital et central dans cette lutte ; pour les prisonnier·es, atteindre leurs objectifs est impossible en dehors de ce cadre ou en s’en isolant. L’une des conditions premières de cet affrontement est l’existence d’une direction organisée et pleinement engagée dans la lutte, en parallèle d’un modèle pratique de travail sur le terrain et un programme quotidien — autant de facteurs qui permettent de traduire une vision et une stratégie en pratique. La réalité à l’intérieur des prisons est régie par ces concepts, et la situation actuelle de la lutte exige de les lire et de les considérer sérieusement.
L’expérience de la lutte entre le Tunnel de la Liberté et le 7 octobre
Il ne fait aucun doute que le “Tunnel de la Liberté” représente un moment clé dans l’histoire du mouvement des prisonnier·es et de sa longue expérience, tant par ce qu’il symbolise que par ses répercussions et effets à l’échelle nationale. Il a surtout contribué à briser un mythe enraciné dans les esprits : celui selon lequel il serait impossible de surmonter cet ennemi, de le vaincre ou d’arracher la victoire. Toute victoire, même de petite taille, représente une avancée importante dans la lutte d’un peuple : elle insuffle de l’espoir, renforce la volonté et élève la conscience. C’est précisément ce que cet événement historique a incarné, influençant également la lutte du mouvement des prisonniers, constituant un tournant significatif et qualitatif. Il a recentré l’attention du prisonnier, de ses considérations personnelles et à court terme, vers la lutte nationale, sa dimension globale et stratégique, reliant la prison à l’ensemble de la patrie. Il a aussi éclairci la relation entre le prisonnier et le geôlier, levé toutes les ambiguïtés, rétabli le rôle actif du mouvement des prisonnier·es et restauré l’idée que l’unité nationale est la clé de chaque affrontement.
Cet épisode a été une illustration pratique de la dimension collective de la lutte. Cela fait partie de l’impact du Tunnel de la Liberté sur la réalité du mouvement des prisonnier·es. L’administration pénitentiaire a vu dans cet événement une occasion de lancer une attaque contre le mouvement des prisonnier·es, cherchant à le démanteler et à contrecarrer les effets du Tunnel de la Liberté, tant à l’intérieur des prisons qu’à l’extérieur, dans son interaction avec la lutte nationale globale. Ainsi, de nombreuses mesures ont été prises : durcissement des conditions de vie quotidiennes, renforcement de la répression contre les prisonnier·es, retrait des acquis, et mise en œuvre de politiques répressives. Cela découlait d’une conviction de plus en plus ancrée parmi les geôliers : celle que le mouvement des prisonniers était fragmenté et incapable de résister ou de faire face à ces mesures, notamment en raison de la division politique intra-palestinienne et de la situation du mouvement des prisonnier·es.
Cependant, le mouvement des prisonnier·es possédait le niveau de conscience nécessaire pour comprendre l’importance de reconstruire un état d’esprit combattif pour mener la confrontation, dépasser les préoccupations triviales ou mesquines, et s’engager pleinement dans notre mission centrale : repousser l’agression globale et l’offensive générale menée par l’appareil colonial sioniste sur les plans sécuritaire et politique.
Cette mission devait être considéré comme la tâche centrale et la première étape de la lutte. Cela signifiait mettre de côté toutes les disputes et s’engager totalement dans cette tache, reflétant un état de prise de conscience avancé nécessitant une application pratique, incarnée par la formation d’une direction d’urgence issue de l’ensemble du spectre politique, créant un corps dirigeant efficace pour l’ensemble du mouvement des prisonnier·es, établissant un plan d’action quotidien pour la confrontation et la résistance, et adoptant la voie de la résistance pour repousser l’attaque. Cela s’est concrétisé par l’élaboration d’un plan pour mener la confrontation — à travers des actions de protestation quotidiennes — exprimant la fusion de la volonté et de l’action, déjouant les calculs de l’administration pénitentiaire. La préparation d’une grève de la faim collective a forcé l’administration pénitentiaire à reculer sur ses mesures et ses politiques répressives.
La phase précédant le 7 octobre
Pendant près de deux ans, une période cruciale de l’histoire du mouvement des prisonnier·es s’est déroulée. Son principal acquis fut la construction d’une unité nationale et l’adoption de la voie de la résistance. Cela a ouvert la voie à de nouvelles réflexions concernant les questions de l’emprisonnement et de sa continuité, ainsi que la lutte pour la libération et ses possibilités. Cela a fait germer l’idée de la “Grève de la Liberté”, qui visait à arracher la liberté des prisonniers ou à embrasser la mort, dont plusieurs leçons et conclusions importantes ont été tirées :
Premièrement : L’affrontement ne peut être réalisé que par la construction d’une unité globale, fondé sur la résistance, le défi et la confrontation. L’unité doit s’établir sur un programme clair et spécifique, inscrit dans un cadre et une vision claires.
Deuxièmement : Repousser l’agression doit être l’objectif prioritaire sur lequel il faut se concentrer, sans se laisser entraîner par les souvenirs et les restes de disputes, de divisions ou encore par des positions politiques divergentes, mais au contraire trouver un terrain d’entente.
Troisièmement : La direction du mouvement doit analyser la situation nationale et doit offrir un modèle d’engagement par son leadership dans la confrontation.
Quatrièmement: La participation collective des prisonnier·es à la grève est le fruit de notre travail pour bâtir l’unité et l’expression de l’harmonie entre la direction et les bases populaires.
Cinquièmement : Repousser l’agression ne se fait pas en la subissant, mais en la combattant et en y résistant par tous les moyens possibles — et légitimes
Sixièmement : La compréhension du rôle et du statut de la conscience nationale dans la lutte
Telles sont quelques-unes des conclusions tirées d’une phase importante, précédant le 7 octobre, au cours de laquelle le mouvement des prisonnier·es a fait face à une attaque féroce et généralisée, et a prouvé sa valeur et sa capacité à relever le défi.
La phase suivant le 7 octobre
Lz 7 octobre marque un autre tournant dans la forme et le niveau de violence imposée par le régime sioniste au mouvement des prisonnier·es. Il y a eu une transition d’une phase de ciblage progressif vers l’imposition des décisions du “Comité Gilad Erdan” du nom de son créateur, le ministre de la Sécurité intérieure sioniste entre 2017 et 2018. Il forma ce comité pour étudier les mesures à prendre contre les prisonnier·es palestinien·nes dans les prisons sionistes.
À l’époque, le comité avait publié un rapport proposant plusieurs mesures de répression, notamment le démantèlement des organisations politiques à l’intérieur des prisons, c’est-à-dire la fin de l’existence d’organisations et de représentations collectives des prisonnier·es, la fin des programmes culturels et académiques, ainsi que le retrait de tous les acquis arrachés par le mouvement des prisonnier·es pour améliorer leurs conditions de vie. Ces propositions, ainsi que les plans pour les mettre en œuvre, étaient donc déjà prêts au sein de l’administration pénitentiaire. Après le 7 octobre, ils sont passés à la phase de guerre totale contre le mouvement des prisonnier·es, lançant un assaut sauvage basé sur un ensemble de politiques et de procédures, résumées comme suit :
Premièrement : La politique de dissuasion
C’est l’un des éléments de la doctrine sécuritaire sioniste qui était pratiquée contre les prisonnier·es avant le 7 octobre, mais dont l’intensité a considérablement augmenté par la suite. Elle est devenue partie intégrante du cadre de la guerre totale contre les prisonnier·es, se manifestant par l’usage d’une violence explosive et sévère contre elles·eux : agressions physiques quotidiennes à l’intérieur des prisons, sans distinction entre prisonnier·es hommes ou femmes, enfants ou personnes âgées.
Ces agressions ont entraîné des milliers de blessé·es parmi les prisonnier·es, et sont la cause de plusieurs martyrs, comme celui du prisonnier Thaer Abu Assab, martyrisé dans la prison du Néguev à la suite d’un passage à tabac. De plus, les descentes répétées jour et nuit dans les chambres et sections des prisonnier·es ont instauré un climat de peur et de tension extrême permanent, des transferts continus, et la confiscation de tous les effets personnels, y compris vêtements, chaussures, montres, appareils électriques, télévisions et radios, transformant les chambres en cellules vides dépourvues des éléments les plus basiques du quotidien des prisonnier·es.
En outre, l’administration pénitentiaire a doublé, voire triplé, le nombre de prisonnier·es par cellule, et utilise cette sur-population comme une forme de maltraitance, de harcèlement et d’intimidation.
Cette politique vise à empêcher toute tentative de résistance de la part des prisonnier·es et à briser leur esprit collectif en mettant fin à leur auto organisation, en abolissant la représentation collective et en supprimant les programmes culturels et d’étude quotidiens. Toutefois, l’un des principaux objectifs, ouvertement affirmé par les responsables pénitentiaires, était la vengeance. Cet élément est central pour analyser le comportement de cet appareil et comprendre son effet sur les prisonnier·es.
Deuxièmement : La politique de la faim
Affamer les prisonnier·es en réduisant d’environ 80 % les quantités de nourriture par rapport aux rations normales a été la première mesure immédiate de cette politique, suivie de la confiscation de tous les aliments présents dans les chambres et sections des prisonnier·es, les forçant à ne dépendre que des maigres repas quotidiens fournis par le régime sioniste. Cela a entraîné une perte de poids sévère chez tous·tes les prisonnier·es, et les corps émaciés et la faiblesse physique constatées parmi les prisonniers libérés témoignait de la famine en cours dans les prisons sionistes. Une simple comparaison entre l’image d’un·e prisonnier·e avant le 7 octobre et après sa libération montre l’ampleur de ce que subissent les prisonnier·es, l’horreur de leur quotidien et la cruauté de la politique de famine imposée par l’administration pénitentiaire. Les quantités de nourriture destinées à une section qui hébergeait auparavant quatre-vingt-dix prisonniers ont été drastiquement réduites, alors même que cette section abrite aujourd’hui environ deux cent cinquante prisonniers. De plus, la nourriture servie est de très mauvaise qualité, sans sel, sans épices, sans huile, et souvent insuffisamment cuite.
L’objectif de la politique de famine est de détruire à la fois le moral et le corps des prisonnier·es, de limiter toute capacité de résilience ou de résistance, et de réduire la pensée des prisonnier·es à un instinct de survie primaire — ce que l’on pourrait appeler une « conscience de la faim ». Ainsi, la faim gouverne le comportement des prisonnier·es et réduit leur réflexion à leur simple survie. C’est une des formes que prends la vengeance de l’administration pénitentiaire contre les prisonniers.
Troisièmement : La politique d’isolement
Cette politique a été mise en œuvre par différents moyens : la suspension des visites de la Croix-Rouge dans les prisons, l’arrêt des visites familiales, la restriction sévère des visites d’avocats, et la confiscation des télévisions, radios et tout moyen de communication, isolant complètement les prisonnier·es du monde extérieur. L’objectif était de briser le moral des prisonnier·es et de les pousser à abandonner toute option de résistance, en faisant des agents pénitentiaires la seule source d’information — une information principalement faite de désinformation, visant à semer confusion et tension parmi les prisonnier·es. Cette politique est l’une des plus dangereuses qui aient été appliquées.
Quatrièmement : La politique d’assassinat médical
La politique de négligence médicale, antérieure au 7 octobre 2023, a été remplacée par une politique d‘assassinat médical délibéré, qui consiste en l’arrêt de la majorité des traitements médicaux fournis aux prisonnier·es et l’abandon du semblant de suivi médical qui existait avant le 7 octobre.
Cela a conduit à la propagation de maladies de la peau — notamment la gale — ainsi qu’à des maladies respiratoires, causant la mort de plusieurs prisonniers.
Les chiffres disponibles indiquent qu’environ 69 prisonniers ont été martyrisés jusqu’à présent en raison de ces politiques.
Cette politique est la cause de maladies chroniques chez les prisonnier·es les menant à la mort. Ces pratiques constituent un crime de guerre, soutenu aux niveaux politiques, judiciaires et sécuritaires du régime sioniste, et qui se poursuit encore jusqu’à maintenant sans qu’il n’y ait eu d’interruption.
Les témoignages des prisonnier·es continuent de dévoiler cette terrible réalité à l’intérieur des prisons sionistes, qui menace la vie des détenus.
Qu’est-ce qui est nécessaire d’urgence, maintenant ?
Dans ce contexte de guerre d’agression et de génocide permanents contre notre peuple partout où il se trouve – et surtout dans ces endroits, à l’intérieur des prisons mêmes, où la torture quotidienne n’a pas cessé un seul jour mais n’a cessé de s’intensifier, une question urgente réapparaît : « Que faire ? » La réponse reste généralement confuse, au vu des formes de cette confrontation contre cette agression, également appliquée à la situation des prisonniers et au fait de la dénoncer. Il y a des efforts désorganisés et dispersés sans accumulation adéquate de réalisations, outre l’absence de planification, de définition d’objectifs, de détermination des buts de la lutte et de la façon de concrétiser ces buts. Peut-être cela est-il dû principalement à l’absence d’une stratégie nationale générale de la confrontation, particulièrement en ce qui concerne les prisonniers, s’appuyant sur la croyance qu’ils seront finalement libérés. Toutefois, cela ne nie pas les crimes qui se sont produits, ni l’importance de la lutte autour de cette cause.
Cette responsabilité nous place devant la nécessité urgente d’organiser et de planifier la lutte autour de la cause des prisonniers, en cherchant à :
Un : Tenter de repousser la guerre déclarée et l’agression contre les prisonniers, l’affronter et exercer des pressions par tous les moyens.
Deux : Mettre en lumière les crimes en cours, les diffuser largement et présenter le discours palestinien de façon large et organisée.
Trois : Documenter le souvenir vivace des prisonniers concernant cette phase historique.
Quatre : Œuvrer à élargir la base de la solidarité mondiale, amplifier la voix des prisonniers, plaider pour le bien-fondé de leur cause et mettre sur pied un mouvement palestinien sérieux.
Réaliser ces buts requiert de larges efforts collectifs, ainsi qu’une volonté générale de lutter pour la libération, et de réaliser effectivement ces buts et d’autres encore. Cela requiert d’étendre ses liens parmi les institutions, mouvements, activistes et autres forces afin de bâtir une coalition internationale efficace sous forme de mécanisme et de bloc, s’appuyant sur des objectifs clairs liés aux prisonniers, à leur liberté, aux souffrances qu’ils endurent et à leur lutte pour leur libération et pour repousser les agressions dont ils font l’objet.
Une telle coalition nécessite une initiative sérieuse en vue d’aborder plusieurs tâches au sein d’un plan d’action, tâches dont les plus importantes sont :
Un : Lancer une campagne internationale de plus en plus intense avec la participation d’institutions et de forces aux niveaux régional et international, organiser périodiquement des événements publics massifs en faveur de la cause des prisonniers.
Deux : S’employer à former une entité pluripartite – palestinienne, régionale et internationale – dont la tâche prioritaire serait de documenter et de répertorier toute expérience de prisonnier après le 7 octobre en tant que projet de mémoire vivante authentique, collective, basée sur la lutte, en tant que témoignage réel sur les crimes de l’occupation, lequel projet devrait être diffusé aussi largement que possible.
Trois : Œuvrer à établir une entité, initiée par des institutions, afin de fournir un soutien et des soins aux prisonniers libérés, particulièrement à ceux qui ont souffert psychologiquement après leurs expériences de détention d’après le 7 octobre.
Quatre : Se concentrer sur l’organisation d’efforts médiatiques sur les réseaux sociaux, lancer une campagne de photos « Avant et Après » pour chaque prisonnier et créer une exposition itinérante de photos, tant dans la réalité qu’électroniquement.
Cinq : Travailler dans le cadre de campagnes sectorielles afin de mettre en lumière les cas des femmes prisonnières, des enfants prisonniers, des détenus administratifs, des malades et des personnes âgées en prison, en présentant chaque prisonnier.e et son histoire – car ils ne sont surtout pas de simples numéros.
Bien des tâches et des idées peuvent contribuer à repousser l’agression contre les prisonniers, mais elles requièrent de la réflexion, des efforts, de la volonté et des initiatives.
Il ne suffit pas, en ce jour, d’aborder simplement la question des prisonniers toute seule. Nous devons plutôt considérer la Journée des prisonniers palestiniens comme une journée d’évaluation de notre rôle – ce qui est requis de nous, ce que nous pouvons faire et ce dont nous avons besoin – de sorte que la cause des prisonniers ne reste pas présente uniquement de façon saisonnière ou occasionnelle.
En savoir plus sur Samidoun : réseau de solidarité aux prisonniers palestiniens
Subscribe to get the latest posts sent to your email.