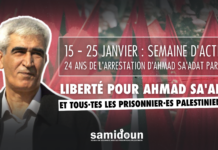Par Benay Blend
Tôt le matin du 17 avril 2024, des centaines d’étudiant·es ont installé des campements sur la place principale de l’université Columbia, à New York.
Dans leurs revendications figuraient le boycott des entreprises profitant de l’occupation sioniste de la Palestine et la transparence sur les liens entre leur université et ces dernières.
Un film récent, The Encampments, coproduit par Watermelon Pictures et Breakthrough News, documente la résurgence de l’activisme pro-palestinien sur les campus ces dernières années.
Inspirés par les manifestations contre la guerre du Vietnam à la fin des années 1960, les étudiant·es ont baptisé leur campement « Zone Libérée ».
Ils auraient aussi pu remonter plus loin, jusqu’aux grèves dans les usines Ford des années 1930.
Étant donné que les universités d’élite sont des incubateurs du leadership américain, l’administration de Columbia a rapidement menacé de mettre fin à l’action étudiante. Deux jours plus tard, la police en tenue anti-émeute est entrée sur le campus avec l’approbation de l’administration.
Tout au long de 2024, les campements se sont étendus à plus de 100 universités, attirant l’attention sur le soutien des États-Unis au génocide mené par le régime sioniste à Gaza.
À mesure que les images de bâtiments détruits et de bébés mutilés inondaient les réseaux sociaux, les protestataires ont intensifié leurs revendications, appelant leurs universités à couper tous liens avec l’état colonial.
Lorsque les responsables ont rétorqué que la procédure de désinvestissement était trop complexe pour être acceptée, les étudiant·es ont rappelé qu’il existait des précédents. Sous pression, les universités avaient procédé à des sanctions similaire contre l’Afrique du Sud du régime d’apartheid, ainsi que vis à vis des entreprises fossiles. Pourquoi alors l’entité sioniste ferait-il exception ?
Les réalisateurs Kei Pritsker et Michael T. Workman couvrent plusieurs mois de vie dans les campements, mettant en avant les motivations profondément éthiques des étudiant·es, en réponse aux accusations d’« extrémisme » ou d’« antisémitisme » lancées par des membres du Congrès, des administrateurs, les médias dominants et certains sionistes.
Il est peut-être regrettable que les réalisateurs aient consacré autant de temps à répondre à ces accusations. Cela permet aux sionistes de dicter le récit, en renforçant une division entre les « bons » et les « mauvais » activistes, entre la protestation non violente et la résistance armée, entre les « bons Palestiniens » et les « mauvais Palestiniens ».
Au final, cela perpétue l’image des Palestinien·nes comme des « victimes parfaites », un rôle que Mohammed El-Kurd critique dans son livre Perfect Victims: The Politics of Appeal (2025). Ce type de représentation nie aux Palestinien·nes le droit d’être vu·es comme des êtres humains dignes, luttant pour la libération de leur terre.
Le film juxtapose des extraits de colons affirmant que les Palestinien·nes se moquent de leurs maisons, de leurs morts, ou de tout ce qui les rendrait humains, à des scènes de destruction à Gaza. Cela illustre les raisonnements irréalistes par lesquels les sionistes justifient le génocide. Comme dans le documentaire de 1974 “Hearts and Minds” qui dénonçait la propagande américaine pendant la guerre du Vietnam, aucune parole n’est nécessaire pour montrer jusqu’où les impérialistes sont prêts à aller pour justifier leurs objectifs.
« Les scènes de destruction à Gaza prouvent l’urgence de la situation et montrent que les revendications des étudiant·es ne sont ni des caprices ni des choses odieuses », affirme Azad Essa. Toutefois, il regrette que le film ignore la résistance palestinienne à Gaza, un élément qui a transformé la solidarité avec la Palestine en crime sur de nombreux campus à travers le monde.
Mettre l’accent sur le choix des étudiant·es pour la non-violence présente, selon Essa, « le danger de diviser les partisans de la cause palestinienne en bons et mauvais protestataires » selon les critères du regard libéral, rejoignant les critiques formulées par El-Kurd dans son ouvrage.
Au final, cet appel n’a pas été entendu, et le gouvernement a poursuivi sa répression, sanctionnant des étudiant·es uniquement sur la base de leurs propos.
Cependant, comme le montrent les réalisateurs, ces accusations sont non seulement infondées mais aussi lourdes de conséquences. Sous l’influence de donateurs sionistes et de groupes d’extrême-droite, elles ont mené à la révocation de visas étudiants et à la détention de titulaires de cartes vertes, comme Mahmoud Khalil, toujours emprisonné en Louisiane.
Comme le note Essa, le film montre « comment l’accusation d’antisémitisme, depuis longtemps instrumentalisée par les soutiens “d’Israël”, est devenue une arme au mains de l’État pour écraser toute opposition à la politique étrangère états-unienne et aux investissements universitaires ». Étant donné que ces accusations venaient d’un groupe d’étudiant·es et de professeurs sionistes, soutenus par l’administration, la police et plusieurs échelons de gouvernement, le film révèle aussi « les délires paranoïaques délibérément mensongers du projet sioniste lui-même. »
Comme les ouvriers en grève dans les années 1930 qui organisaient des cours d’histoire du travail, ces campements intégraient une dimension culturelle et éducative : les étudiant·es y apprenaient le dabké et étudiaient les mouvements de décolonisation passés et présents.
À l’image du mouvement Occupy, les étudiant·es ont construit une communauté selon les valeurs qu’ils souhaitent voir advenir : un espace de détente et d’apprentissage, de partage de nourriture pour que personne n’ait faim, un lieu où les différences sont respectées autant que les points communs.
Face à des forces écrasantes, le mouvement a visiblement pris fin à l’approche de l’été. Mais comme l’a écrit l’écrivain et révolutionnaire Ghassan Kanafani : on peut tuer des individus, mais on ne peut pas tuer des idées.
« Beaucoup d’étudiants ne vont pas s’arrêter », conclut le réalisateur Kei Pritsker. « Je ne pense pas que quiconque ait rejoint le mouvement pour la Palestine en pensant que cela allait être sans conséquence sur sa sécurité. La plupart d’entre nous savaient que cela nous exposerait à des risques. Mais rien de tout cela ne compte, car si l’un·e d’entre nous, quelque part, vit sous la menace d’un bombardement ou d’un tir à tout moment, alors aucun·e de nous n’est en sécurité. »
En savoir plus sur Samidoun : réseau de solidarité aux prisonniers palestiniens
Subscribe to get the latest posts sent to your email.